
Avec « Femmes-Soleils », la metteure en scène et dramaturge ouvre, avec les héroïnes de l’histoire d’Haïti, une rencontre et une expérience spirituelles assorties de référents culturels qui structurent notre identité de peuple, pour nous porter à nous révéler à nous-mêmes.
Aussi la pièce nous pousse-t-elle à nous interroger et à nous demander : dans les profondeurs de notre être, y a-t-il suffisamment d’énergie pour renaître et retrouver un chemin de compréhension pour l’inclusion de tous les enfants d’Haïti ?
Un besoin de valorisation et ras-le-bol
Le décor est planté. Lumière. Un groupe d’élèves prépare une exposition. Au moment de la préparation de cet espace de présentation d’œuvres et d’objets d’art autour du thème de la fête du Drapeau, un débat animé s’engage entre Esperanza, Wana, Tomy, trois élèves de terminale au cœur de l’organisation de cette manifestation culturelle.

« Je ne vois pas pourquoi tu te fatigues ainsi. Si tu crois que les élèves de cette école sont intéressés tant que ça à cette expo, tu te fais des illusions, ma chère. La fête du Drapeau ! Tout le monde s’en fout… Ça permet juste d’avoir un jour de congé, c’est tout », balance Wana à Esperanza qui se donne à fond pour transmettre un message et créer une réaction du public avec ce qu’on propose à cet événement. À la vue du public – composé des élèves de J’apprends, institution privée mixte de Thomassin, de lycée Benoît Batraville, du collège Diocésain de Thomassin, de la Maison enchantée de Myrlande, du collège diocésain Saint-Vincent de Paul, de l’Institution Louis Chauvet, – Esperanza illustre cette recherche de l’art à travers un besoin de valorisation de nos repères et de nos traditions.
À l’arrière plan de la scène, quatre femmes vêtues d’habits datant du début du XVIIIe siècle sont en relief dans un tableau qui les fige pour l’éternité. Cette image qui évoque l’histoire de nos héroïnes dans un habile cadrage s’embrasse du regard à n’importe quel endroit de la salle. La scène vivante, en continuel mouvement par rapport à l’œuvre d’art, dégage une atmosphère qui finit par entraîner les jeunes à se focaliser sur l’actualité du pays.

Éclats de voix. Agressivité. Énervement. L’atmosphère est chargée d’électricité. Les trois amis passent en revue l’échec d’Haïti et expriment leur ras-le-bol avec des mots cinglants. Wana, pour sa part, remet en question l’exposition. Elle se demande même pourquoi on continue à célébrer le 18 mai en Haïti. « Ça ne m’intéresse pas ! Chaque homme politique, chaque dirigeant de ce pays, à chaque discours, nous renvoie immanquablement à notre passé glorieux, au destin héroïque de notre peuple et bla bla bla. Ils se gargarisent des exploits de nos ancêtres pour nous étourdir, nous engourdir et nous faire accepter cette descente aux enfers interminable. J’en ai assez ! Je ne veux plus qu’on me raconte des histoires, leur histoire. J’ai juste besoin qu’on me laisse vivre la mienne, écrire ma propre histoire, pas celle tragique de ce pays ! Seul le présent m’intéresse. Le présent ! », s’insurge Wana tout en disant réaliser que la seule porte de sortie pour la jeunesse haïtienne, c’est de partir.
Une voix, un chœur, une lumière, un chemin
À côté des paroles défaitistes de Wana monte une voix inspirée, pleine d’espoir, celle d’Esperanza : « Comment peux-tu comprendre le présent si tu ne connais pas le passé ? Notre histoire n’est pas que tragique, elle est extraordinaire, sublime, universelle. Nous avons changé l’histoire du monde ! Comment peux-tu blasphémer de la sorte, surtout après que nos ancêtres ont fait ce travail-là ? »

Accrochée à l’opportunité que donnera cet événement qui permettra au public de réfléchir sur les questions liées à l’histoire du pays et à la société, Esperanza éprouve une fierté à voir dans la salle qui accueille l’exposition de son école, Catherine Flon et toutes ces femmes exceptionnelles. Elle est comme envahie par la présence de ces esprits qui la renvoie au temps héroïque.
Dans cette pièce, Esperanza devient une voix de lumière qui cherche un chemin dans le tumulte, une voix qui cherche des repères pour s’accrocher. C’est dans ce contexte que les héroïnes sortent du cadre et prennent corps dans la réalité. Wana et Esperanza découvrent, ahuries, ces héroïnes : Cathrine Flon, fille naturelle de Jean-Jacques Dessalines, qui a cousu le drapeau le 18 mai 1803 lors du congrès de l’Arcahaie ; Cécile Fatiman, résistante prêtresse vodou qui a organisé le rassemblement ayant permis le ralliement des chefs rebelles à la cérémonie du Bois Caïman; Claire Heureuse, résistante, impératrice, femme du fondateur de la Nation; Marie-Jeanne, résistante, soldate qui s’est distinguée pas sa bravoure lors de guerres de l’indépendance d’Haïti ; Anacaona, reine taïno, première résistante aux colonisateurs espagnols, XVIe siècle.
Il faut voir « Femmes-Soleil » pour écouter les messages que portent nos héroïnes. Il faut observer l’effarement de deux jeunes filles éloignées de toutes préoccupations d’ordre spirituel et aussi prêter l’oreille aux mots et au langage du corps riche et expressif durant cette expérience ineffable pour prendre la mesure de la dimension de cette pièce.

« Qui êtes-vous ? », demande Wana à ces femmes sorties tout droit du tableau. Elles répondent en chœur : « Nous sommes les femmes-flambeaux, les femmes-flammes, nous sommes les porteuses de lumière. »
Cette dimension spirituelle de la rencontre qui se déploie sous les yeux agrandis d’émotion de Wana et d’Esperanza n’entre pas en résonnance avec leur culture judéo-chrétienne.
Wana n’en croit pas ses yeux. « Jésus, Marie, Joseph ! Madame, je suis chrétienne, moi ! Je ne pratique pas le vodou, toutes ces choses bizarres de sorcellerie, de cérémonies effrayantes, de wanga. Je n’ai pas été élevée dans ce genre de pratiques. »
À partir de cette scène la dramaturge soulève un voile dans une société qui essentialise les gens pour mieux les tenir à l’écart. Et comme la religion de la majorité du peuple est le vodou, c’est la majorité qui sera diabolisée et rejetée dans la marge à cause de leur confession de foi.
Dans la préface de « Femmes-Soleils » que Florence Jean-Louis Dupuy avait signé l’année dernière à Livres en folie, Yole Derose a écrit : « Là, ces femmes-soleils surgissent du tréfonds de nous-mêmes pour livrer le message qui nous exalte et nous effraie à la fois. Un message clair que tout n’est pas perdu malgré cette plongée abyssale, et que seule la connaissance de notre histoire vraie et notre combativité peuvent nous permettre de freiner. Le maître-mot à retenir ici est que notre chute libre identitaire n’est que la conséquence de notre méconnaissance de notre histoire de peuple et de race. »
Une expérience transcendante
Comment Wana et Esperanza sont-elles parvenues à accéder à une expérience transcendante, le temps d’une apparition soudaine des héroïnes qui ont marqué l’histoire d’Haïti ?

À cette haute expérience humaine la porte d’accès de l’invisible s’ouvre à Wana et à Esperanza. Tomy, lui, le compagnon étourdi, plongé dans un sommeil, est à mille lieux de cette réalité. Cette expérience singulière qui prend corps à travers le souffle de nos héroïnes entretien une rencontre véritable.
Catherine Flon parle et sous ses injonctions, on se tait : « Ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Depuis que le monde est monde, il n’existe sur cette terre que deux forces : celles qui sont au service du bien et celles qui répandent le mal. Laisse tomber tous les préjugés qui t’ont été inculqués et ouvre-toi à la vérité. Tu es libre de choisir la route qui te correspond le mieux pour te connecter à la source, mais ne crache pas sur le chemin tracé par tes ancêtres. Nos croyances ancestrales sont inscrites dans notre spiritualité, comme les souvenirs de l’esclavage le sont dans notre mémoire collective. Le vodou fait partie de nous, de vous. Le renier c’est se livrer une guerre à soi-même. Oui, certains d’entre nous ont utilisé des connaissances transmises à des fins personnelles, pour faire du mal. Mais des êtres maléfiques existent aussi chez les catholiques, les protestants, les bouddhistes et les musulmans. Aujourd’hui, nous sommes venues pour éveiller vos âmes à toutes les deux… Ouvrir votre conscience et vous préparer à votre tâche. »

Catherine Flon annonce aux jeunes filles que l’heure du réveil a sonné. Le peuple doit se rassembler pour la reconstruction de la « Nouvelle Ayiti ».
Esperanza, plus sensible aux messages, sera choisie pour continuer à transmettre le message. À travers une expérience qui lui permet de transcender tous les états de conscience pour aller au-delà de la conscience individuelle, Esperanza, soudain, est chevauchée par un esprit, celui de la reine Anacaona : « Je suis le principe féminin. Mais surtout, en vérité, je vous le dis : je suis vous et vous êtes moi. »
Avec cette pièce qui baigne dans le merveilleux, Florence Jean-Louis Dupuy s’adresse au peuple pour nous dire que la résurrection d’Haïti viendra de la matrice ; elle viendra des gens qui ont du cœur, des gens qui ont une conscience et qui souhaitent de toute leur âme que Haïti sorte de ce bourbier.
Avec « Femmes-Soleils », elle donne un outil intellectuel aux jeunes pour réfléchir et trouver un chemin dans ce chaos qui fragilise les esprits et qui met le pays quotidiennement sur un baril de poudre.
Claude Bernard Sérant
serantclaudebernard@yahoo.fr
Esperanza / Anacaona : Esmeralda Dimanche ; Wana : Berlie Joseph ; Tomy : Abhelard Mirtzy François ; Marie Jeanne : Micaelle Charles ; Catherine Flon : Stephanie Saint Louis ; Cécile Fatiman : Jenny Cadet, assistante metteure en scène ; Claire Heureuse : Emmanuela Bazile ; Danseurs de Haïti tchaka danse ; « Femmes-Soleils », une pièce signée Florence Jean-Louis Dupuy.
Pour accéder à cette vidéo, cliquez ici
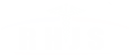
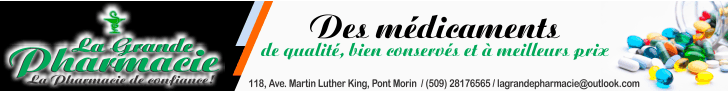















Discussion à propos de post