
Abinader mise sur la coopération régionale
Le président Luis Abinader a exposé les grandes lignes des discussions avec le secrétaire d’État Marco Rubio, mettant l’accent sur trois axes majeurs, tout en prenant soin de vanter le rôle stratégique de la République dominicaine en tant qu’allié clé dans la région en matière de sécurité : la coopération sécuritaire; les questions migratoires; les zones franches et le commerce bilatéral.
Abinader et la crise haïtienne : un porte-parole auto-proclamé ?
Sans grande surprise, Luis Abinader, qui semble s’être auto-proclamé porte-parole d’Haïti sans mandat des Haïtiens, a profité de sa rencontre avec Marco Rubio pour évoquer la crise haïtienne. Exploitant le vide institutionnel qui paralyse Haïti, il a plaidé pour une réponse robuste et coordonnée de la communauté internationale.
S’il affirme qu’«il n’existe pas de solution dominicaine à la crise haïtienne», une question s’impose : Qui a sollicité une solution dominicaine ?
L’implication active de la République dominicaine dans la crise haïtienne est-elle motivée par une réelle volonté d’aider, ou par des intérêts stratégiques liés à la migration et à l’économie ? Aucune réponse claire à l’horizon.
Le président Abinader a insisté sur l’urgence d’un soutien financier accru pour la mission menée par le Kenya, censée ramener une certaine stabilité en Haïti. Sur la même lancée, il a décrit la situation haïtienne en des termes alarmants, la qualifiant de « jour de feu et de sang ». Il est même allé jusqu’à affirmer qu’Haïti se noie et représente une menace sécuritaire pour la région, y compris pour les États-Unis.
Ces propos font écho à ceux de Marco Rubio lors de son audition au Sénat américain. Abinader a réitéré que ni la République dominicaine ni les États-Unis ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités dans cette crise. Il a également insisté sur la nécessité d’une détermination ferme, déclarant que « le leadership américain est indispensable et irremplaçable ».
Mais alors, Monsieur le « porte-parole d’Haïti », cette déclaration reflète-t-elle la position de la République dominicaine ou celle du pays de Jean-Jacques Dessalines ?
Une surveillance accrue du territoire haïtien s’impose
Ces déclarations doivent inciter Haïti à renforcer la vigilance sur son territoire et ses ressources naturelles, notamment dans les zones frontalières. Les récents développements dans la zone de Pedernales soulignent l’urgence d’une surveillance accrue, en particulier dans la région d’Anse-à-Pitres.
Une question cruciale demeure : Pourquoi Haïti ne dispose-t-elle pas d’un rapport public et actualisé sur ses richesses minières ?
Selon les informations du Bureau des Mines et de l’Énergie, les secteurs mines et énergie ont connu deux grandes périodes d’exploitation : 1939-1972 : Travaux de recherche sur les énergies fossiles; 1972-1992 : Développement des deux secteurs, mais sans véritable suivi depuis lors.
Sur la carte du potentiel minier et énergétique d’Haïti, on note que dans les zones limitrophes à la province de Pedernales, notamment Anse-à-Pitres, Thiotte, Fond-Verettes, Thomazeau et Ganthier, plusieurs ressources métalliques, non métalliques et énergétiques sont identifiées.
Pendant ce temps, la province de Pedernales, située à l’extrême sud-ouest de la République dominicaine, connaît un développement accéléré et se transforme en une destination touristique de premier plan.
Dans ce contexte, les forces vives de la nation haïtienne doivent exiger une étude approfondie et transparente sur les ressources naturelles, tout en veillant à éviter toute infiltration d’acteurs aux intérêts dissimulés. Il est de notoriété publique que certains fonctionnaires haïtiens occupant des postes stratégiques jouent le rôle d’agents doubles pour la République voisine, dont les services de renseignement sont très actifs à tous les niveaux de l’administration publique et privée haïtienne.
En clair, le voisin est présent dans tous nos projets et détient des informations sensibles sur nos ressources. Aussi est-il impératif de mettre en place : un système de contrôle accru des zones stratégiques; une diplomatie proactive pour éviter que d’autres pays ne dictent l’avenir d’Haïti.
Marco Rubio et l’enjeu des terres rares : Une nouvelle priorité américaine ?
De son côté, Marco Rubio a mis en avant un dossier stratégique : l’économie et les terres rares. Selon lui, ces éléments seront déterminants pour l’économie mondiale dans les décennies à venir.
Le sénateur américain a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec Luis Abinader pour explorer ces ressources et a évoqué la possibilité de faire appel au Corps des ingénieurs de l’armée américaine. Déjà impliqué dans certains projets en République dominicaine, ce corps pourrait jouer un rôle dans l’identification et l’exploitation des terres rares.
Bien que Rubio n’ait pas annoncé de décision officielle, il a laissé entendre qu’une initiative d’envergure pourrait voir le jour, marquant ainsi un tournant majeur dans les relations entre les deux pays.
En voilà une affaire à suivre…
Marnatha I. TERNIER
Sources : State.gov/secretary; Bureau des Mines et de l’Énergie – Haïti
À lire, en un clic, ces articles signés de la même auteure:
1
Déclarations de Marco Rubio, secrétaire d’État américain, sur Haïti
2
3
Haïti entre théâtre diplomatique et crise réelle, un destin en suspens
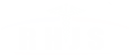
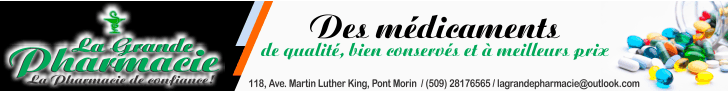















Discussion à propos de post