Par Marnatha I. Ternier

En 1825, sous la menace d’une intervention militaire, la France contraint Haïti à verser 150 millions de francs-or, somme réduite à 90 millions en 1838, en « compensation » des pertes subies par les anciens colons esclavagistes, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette somme, financée par des emprunts à des taux élevés auprès de banques françaises et américaines, fut remboursée par Haïti jusqu’en 1952.
En 1947, sous la présidence de Dumarsais Estimé, Haïti effectue le dernier paiement de cette dette odieuse, plus de 120 ans après avoir conquis sa liberté au prix du sang. Pourtant, en 2004, année du bicentenaire de notre indépendance, la diplomatie française enterre le débat sur la restitution, en s’appuyant sur une frange influente de la classe intellectuelle haïtienne, qui ira jusqu’à proposer elle-même un « nouveau contrat social ». Dans le même souffle, cette manœuvre s’accompagne d’un soutien tacite, puis explicite, au renversement d’un président démocratiquement élu, avec la complicité d’acteurs politiques et académiques locaux.
Changement de paradigme
Le colon, désormais, a changé de méthode : Jésus, comme Colomb, ne reviendra pas sous sa forme initiale, il utilise désormais notre sang et notre propre rang pour faire atterrir son agenda. Les insurgés, entraînés et armés depuis la République dominicaine, ont opéré dans l’ombre de réunions secrètes tenues chez le voisin.
Et lorsque le régime tombe, les récompenses pleuvent : sièges dans le gouvernement provisoire, bourses dans les musées français, visas dorés. Le prix du silence.
Macron : une blessure sans remède
Le 17 avril 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, marque le bicentenaire de la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti par la France avec un discours fort en symbole, faible en engagements. Il déclare : « Cette dette n’est pas seulement une dette historique ; c’est une blessure ouverte.
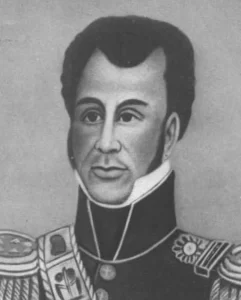
(…) Ce que la France a fait à Haïti, elle ne l’a fait à aucun autre peuple. » Par cette allocution, Macron tente de repositionner la France comme acteur de justice historique, sans ouvrir la voie à des réparations financières. Il annonce la création d’une commission franco-haïtienne chargée d’examiner cette histoire commune et de formuler des recommandations pour l’avenir. L’avenir, « n’ayant ni limite ni fin ». Une manœuvre habile pour gagner du temps, sans s’engager concrètement. Macron évoque une faute morale. Mais toujours aucune proposition de réparation. Le passé est reconnu, mais l’addition… que dire ? la facture reste impayée.
Hollande : dette évoquée, espoir déçu
En mai 2015, en tournée dans les territoires d’outre-mer et les Caraïbes, François Hollande annonce depuis la Martinique sa visite historique en Haïti. Lors de son discours à l’Université d’État d’Haïti, il déclare : « La France a imposé à Haïti, au 19e siècle, une dette, une rançon de l’indépendance. (…) Je viens ici pour que nous puissions régler cela. »

Mais dès le lendemain, l’Élysée clarifie : aucun remboursement prévu. Le « règlement » ne sera que symbolique. Hollande opte pour la prudence juridique. Macron, dix ans plus tard, joue la confession morale. Ni l’un ni l’autre ne proposent d’action réparatrice.
Comparaison Hollande / Macron
| Thème | Hollande (2015) | Macron (2025) |
| Ton | Prudent, juridique | Tragique, confessionnel |
| Message | Justice symbolique | Dette morale et blessure ouverte |
| Actions concrètes | Coopération minimale | Initiative “France-Haïti 2030” |
| Réparation financière | Aucune | Aucune |
Colonialisme à géométrie variable
L’État français a déjà adopté des démarches similaires avec l’Algérie et le Cameroun, sans oublier la tragique histoire du pays de Paul Kagamé : le Rwanda. Après le génocide, ce pays de la région des grands lacs a fait un grand virage vers le monde anglophone. Le français, langue du colonisateur belge, est rejeté ; l’anglais est adopté comme langue d’enseignement. Dix ans plus tard, la colère s’est apaisée ; les blessures de l’âme, moins vives. Kagamé effectuera un rééquilibrage très smart en faisant se côtoyer l’anglais, le français et les langues locales (kinyarwanda et swahili), dans son pays.
L’annonce d’une commission franco-haïtienne pourrait sembler prometteuse, mais elle illustre surtout la stratégie française : encadrer les récits postcoloniaux tout en évitant l’engagement juridique des réparations.
La dette : un pillage économique durable
Cette rançon a littéralement saigné l’économie haïtienne. Pendant plus d’un siècle, Haïti a sacrifié ses ressources à cette dette, au détriment de son développement, de ses infrastructures et de son système éducatif. Les traces sont profondes, durables, et expliquent en partie l’extrême fragilité institutionnelle d’aujourd’hui. Les blessures laissées sont aussi nombreuses que les racines de notre liberté. Cette dette est mère de la pauvreté chronique et de l’instabilité politique actuelle.
Géopolitique et guerre des influences
En avril 2025, Macron agit aussi dans un contexte stratégique : Haïti, soutenue par la Caricom, a porté la question des réparations à l’Assemblée générale de l’ONU (2023). Parallèlement, la France tente de contenir l’influence anglo-saxonne dans la région.

Après une rencontre tendue avec Donald Trump à la Maison-Blanche le 28 février 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu au Royaume-Uni, à Londres pour un sommet d’urgence avec treize pays de l’Union européenne, le Canada, la Norvège et le Royaume-Uni. Ensuite, il a poursuivi sa tournée à Paris pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Ce détour souligne les enjeux énergétiques et miniers qui motivent les puissances à s’implanter ou à soutenir des missions, comme celle du Kenya en Haïti, appuyée par une note conjointe France–Royaume-Uni publiée le 16 avril 2025.
Le support s’étend aussi à la Caricom composée de 15 États, dont 12 sont d’anciens territoires britanniques, et cinq sont encore des royaumes du Commonwealth. Si la diplomatie était un miroir, son reflet nous dirait davantage.
Entre mémoire et justice différée
La France avance masquée. Entre mémoire diplomatique et justice différée, elle refuse toujours de répondre au fond de la question : comment réparer l’irréparable ?
Et pendant que les grandes puissances s’affrontent autour de l’avenir d’Haïti, le peuple reste coincé entre l’humiliation du silence et la colère de l’oubli. Comme l’aurait dit Jawaharlal Nehru : « Quand les éléphants se battent, c’est l’herbe qui souffre. »
La France demande à Haïti d’oublier ; Haïti, elle, exige d’être entendue.
En attendant, les préjudices des siècles ont fait le lit de nos malheurs. Ce sont nos propres mains mûes par des logiciels qui appuient sur le bouton « delete ». Pour effacer l’histoire. Pour la réécrire sur de nouvelles pages. Aujourd’hui plus que jamais la culture dans l’ère de temps s’inscrit dans le narratif.
Marnatha I. Ternier
Sources:
Déclaration d’Emmanuel Macron, Élysée.fr – 17 avril 2025
Discours de François Hollande, Le Monde – 12 mai 2015
Rapport Duclert sur le Rwanda – 2021
The Ransom, The New York Times – 2022
Discours d’Haïti à l’AGNU – Session 2023
ABC News – Zelensky in London – mars 2025
Communiqué France–UK sur la mission en Haïti – 16 avril 2025
Organisation des États de la Caraïbe – CARICOM.org
Du même auteur
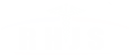
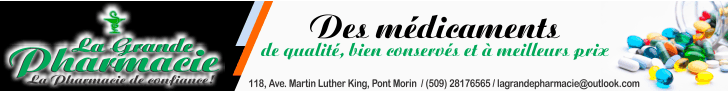














Discussion à propos de post