Pour marquer le 38ᵉ anniversaire de la Constitution Haïtienne amendée de 1987, le réseau Haïtien des Journalistes de la Santé RHJS, sous la direction de son nouveau comité, a organisé une conférence-débat autour du thème : « Droit à la santé en Haïti : entre garanties constitutionnelles et réalités pratiques. »
Par Sonia Paul

L’évènement s’est tenu ce samedi 29 mars 2025, au siège de l’institution, situé au 12, impasse Vieux Delmas 48. Il a réuni des experts en droit, médecine et communication, parmi lesquels maître Patrick Laurent, avocat au barreau de Port-au-Prince, le Dr Raphaëlla Lopez et le cadre du RHJS, journaliste et communicateur social, Sabry Iccenat.
Sous le regard attentif des participants et de plusieurs journalistes, la discussion a été riche et engageante, favorisant un échange constructif entre les experts et le public.
Un débat enrichissant sur les obligations de l’État
Selon Me Patrick Laurent, le droit à la santé ne se limite pas à l’accès aux soins médicaux, mais englobe également un environnement sain, sécurisé sur le plan sanitaire et social, ainsi qu’une politique efficace de prévention. Il a également tenu à distinguer le droit médical et le droit à la santé. Le droit médical régit les relations entre les professionnels de santé et les patients dans le cadre de l’exercice médical. Le droit à la santé, quant à lui, est garanti par la Constitution haïtienne, notamment aux articles 19 et 23, qui imposent à l’État le devoir de protéger la vie et la dignité des citoyens. Cela passe par la création d’hôpitaux, de dispensaires et de centres de santé accessibles à tous.

Toutefois, Me Laurent a souligné une lacune majeure dans la Constitution haïtienne : l’absence de dispositions claires sur l’obligation de l’État en matière de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la santé. La disponibilité des infrastructures est une chose, mais sans un personnel médical compétent et en nombre suffisant, le droit à la santé reste une promesse inachevée.
Un plaidoyer pour une politique de santé inclusive
Le Dr Raphaëlla Lopez a insisté sur l’importance d’un accès équitable à la santé, sans aucune forme de discrimination. Elle a également mis en lumière les responsabilités de l’État dans la mise en place d’une véritable politique de santé publique qui ne se limite pas aux infrastructures, mais inclut aussi la formation et le maintien en poste des professionnels de santé
Pour le communicateur social et journaliste Sabry Iccenat, cette rencontre offre une opportunité d’échange qui permet d’apporter des perspectives nouvelles sur les enjeux sanitaires et constitutionnels en cette date significative. Dans un premier temps, Sabry Iccenat a tenu à définir le concept central « inégalité », qu’il a qualifié de différence engendrant une forme d’injustice. Pour étayer son propos, il s’est appuyé sur la pensée du philosophe Jean-Jacques Rousseau, notamment ses analyses sur l’inégalité naturelle et l’inégalité morale et politique.

L’inégalité naturelle, selon Rousseau, découle des différences physiques inhérentes à chaque individu (force, intelligence, santé). L’inégalité morale et politique quant à elle, résulte d’une construction sociale qui privilégie certains groupes au détriment d’autres, générant ainsi des rapports de domination.
Iccenat a mis en avant le caractère socialement construit de l’inégalité, expliquant qu’elle est souvent le produit d’un système organisé au bénéfice d’un groupe de personnes, tout en marginalisant d’autres catégories de la population.
Dans le troisième volet de son intervention, Sabry Iccenat a abordé les disparités géographiques dans l’accès aux soins de santé en Haïti. Il a souligné qu’il existe un écart considérable entre les infrastructures médicales des zones urbaines et celles des zones rurales. Certaines régions reculées, a-t-il dit, sont totalement dépourvues de centres de santé adéquats. Selon lui, l’inégalité constitue un défi majeur pour la mise en œuvre pour un véritable droit à la santé en Haïti.
Cette conférence-débat a permis de mettre en évidence les écarts entre les garanties constitutionnelles et la réalité du droit à la santé en Haïti. Si la Constitution prévoit des obligations claires, leur mise en œuvre reste encore fragile, notamment en raison du manque d’infrastructures adaptées, de financements insuffisants et d’une main-d’œuvre médicale sous-évaluée.
Enfin, Face à ces défis, l’engagement de tous journalistes, les médias, les acteurs, y compris les citoyens engagés, les professionnels de santé et les décideurs politiques, sont essentiels et pour que le droit à la santé devienne une réalité tangible pour chaque Haïtien. L’État, en tant que garant des droits fondamentaux, se doit d’agir avec plus de rigueur et d’efficacité afin de respecter ses engagements constitutionnels et améliorer les conditions sanitaires du pays.
Sonia Paul
soniapaul139@gmail.com
Accédez à cette vidéo en cliquant ici
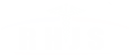
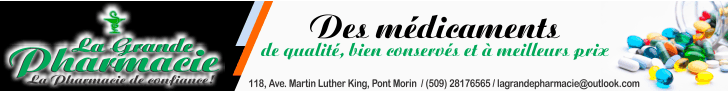













Discussion à propos de post