La situation socio-politique d’Haïti, marquée par une instabilité chronique, affecte gravement les quartiers les plus vulnérables, tels que le Fort National. En effet, la précarité économique, combinée à l’absence quasi totale de services publics essentiels, accentue les inégalités sociales et crée un environnement propice à la prolifération des violences basées sur le genre (VBG). La fragilisation de l’État et l’aggravation de l’insécurité généralisée ont des répercussions dramatiques, particulièrement pour les femmes et les filles, qui, souvent premières victimes de cette violence systémique, voient leur situation se dégrader au quotidien.

Les différentes formes de violences dans un contexte de chaos politique
Au cœur de cette crise, les violences sexuelles connaissent une intensification inquiétante. Les violations collectives, les agressions sexuelles exercées par des groupes armés et la violence sexuelle en période de conflit sont désormais monnaie courante dans des zones telles que Fort National. Dans ce climat de guerre ouvert entre gangs armés, exacerbé par l’absence d’un État de droit, les femmes deviennent des cibles stratégiques. Les agresseurs les utilisent comme instruments de domination, afin d’imposer leur pouvoir sur un territoire en proie à l’anarchie. Par ailleurs, les violences domestiques, dont la fréquence augmente, restent un fléau omniprésent. Les conditions de vie extrêmement difficiles, caractérisées par une forte pression économique et des tensions sociales, exacerbent ce phénomène. Les conflits familiaux se transforment souvent en scènes de violence, en particulier lorsque la stabilité matérielle et psychologique des foyers est mise à mal par l’instabilité générale.
Les facteurs liés à l’instabilité
L’insécurité généralisée constitue l’un des principaux moteurs des violences basées sur le genre à Fort National. Les affrontements réguliers entre gangs armés perturbent non seulement le quotidien des habitants, mais exposent également les femmes à des risques accrus de violence physique et sexuelle. Ces combats entraînent également des déplacements forcés et en masse, laissant des familles sans ressources ni protection, et engendrent des situations de vulnérabilité accumulées pour les femmes, souvent contraintes de fuir avec leurs enfants dans des conditions précaires.
L’effondrement de l’économie haïtienne constitue également un facteur aggravant. Le chômage élevé, l’inflation galopante et la désorganisation des secteurs économiques obligent de nombreuses femmes à dépendre financièrement de leurs agresseurs. Cette situation crée un cercle vicieux, enfermant les victimes dans une dépendance qui les empêche de s’extraire du cycle de la violence. En outre, les quartiers surpeuplés, souvent dépourvus d’infrastructures adéquates, deviennent des lieux propices à la propagation des violences, en raison de la promiscuité et de la précarité qui y règnent.

La fragilité des institutions judiciaires, corrompues et inefficaces, constitue un autre obstacle majeur à la lutte contre les VBG. Le système judiciaire haïtien, paralysé par des décennies de dysfonctionnement, empêche de nombreuses victimes de violences de faire entendre leur voix. L’absence de confiance dans l’appareil judiciaire, associée à la crainte des représailles, dissuade les femmes à signaler leurs agresseurs. Cette impunité institutionnalisée renforce le cycle de violence, car elle nourrit la perception que les auteurs de crimes violents peuvent agir sans crainte de sanctions.
Enfin, les normes socioculturelles profondément ancrées, notamment les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales, entretiennent une culture du silence. Les femmes qui cherchent à dénoncer les violences auxquelles elles sont soumises se heurtent souvent à la stigmatisation sociale et au rejet de leur communauté. Cette situation est exacerbée par la honte et la peur de la marginalisation qui augmentent le nombre de victimes à se taire.
Pistes de solutions et perspectives d’avenir
Malgré l’ampleur de cette crise, certaines initiatives locales tentent de répondre aux besoins urgents des victimes de violences basées sur le genre. Des organisations communautaires, bien qu’ayant un impact limité par le manque de ressources, mènent des actions de sensibilisation et offrent un soutien psychosocial aux victimes. La campagne de sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) organisée par le Réseau Haitien des Journalistes de la Santé (RHJS) pour 100 jeunes venant de Saint-Martin et Fort National dont j’ai participé. Cependant, ces efforts restent insuffisants au regard de l’ampleur du problème.

Il est donc impératif d’adopter une approche globale et systémique pour lutter contre ce fléau. Cela inclut la mise en place de mécanismes de protection renforcés, tels que des centres d’accueil sécurisés pour les victimes. Il est également essentiel de former les forces de l’ordre à la prise en charge des cas de VBG, afin d’assurer une réponse efficace et professionnelle. Par ailleurs, le développement de programmes d’autonomisation économique pour les femmes est une priorité, afin de leur permettre de se libérer de la dépendance à leurs agresseurs et d’améliorer leur qualité de vie. Enfin, une campagne d’éducation civique et sexuelle est nécessaire pour déconstruire les stéréotypes de genre et instaurer une culture du respect et de l’égalité.
Les violences basées sur le genre à Fort National sont le reflet des effets dévastateurs d’une instabilité socio-politique prolongée en Haïti. La résolution de cette crise exige une coopération étroite entre les communautés locales, les organisations internationales et les autorités publiques. Ce n’est qu’à travers une action concertée et un engagement fort que l’on pourra envisager un avenir où les femmes et les filles vivront en sécurité et pourront pleinement s’épanouir.
Daana Sthernith Eldimé
dastel@wikimediahaiti.org
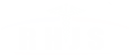
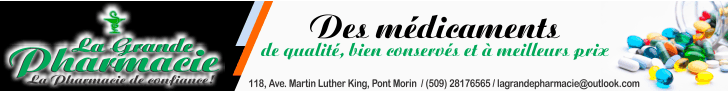














Discussion à propos de post